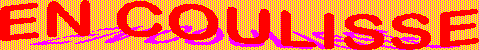Les
Chroniques
de
 |


 |
 
21ème
Saison
Chroniques 20.081
à
20.085 Page
417
D'un Théâtre
L'Autre
© Theothea.com
© Theothea.com
© Theothea.com
70ème
Festival de
Cannes
2017
La Croisette 2017
Les Molières
2017
Les Nominés &
Lauréats 2017
Les
Molières
2017
R E V I V A L
Stones 14 on Fire
Paris
Wight ! + 46 années
après
Toutes
nos
critiques
2016 -
2017
Les
Chroniques
de
Theothea.com
sur

THEA
BLOGS
Recherche
par mots-clé
THEA
BLOGS
|
ERICH VON STROHEIM
de
Christophe Pellet
mise
en scène Stanislas Nordey
avec
Emmanuelle Béart, Thomas
Gonzalez & Laurent Sauvage (ou Victor de Oliveira) |
****
Théâtre du
Rond-Point
|
Voici « Elle, l’Un et l’Autre » dûment
en trio, à l’instar d’une Emmanuelle Béart flanquée
des « Jules & Jim » valeureux soupirants ou clones
du désenchantement partagé à trois selon toutes les
combinatoires de duos envisageables, qui pourraient s’adonner aux
interrogations tournant sur elles-mêmes de manière infinie...
au Rond-Point.
Au sein d’une proposition d’une dizaine de textes
théâtraux sélectionnés personnellement par Stanislas
Nordey, en perspective d’une création originale laissée
au choix d’Emmanuelle, celle-ci s’éprit alors
d’« Erich Von Stroheim » en raison de son énigme
existentielle ouverte restant non résolue.
La comédienne, ainsi séduite par le concept circulaire du
triptyque amoureux induit par son auteur Christophe Pellet, pensait de
surcroît que ce flux libidinal atypique forcerait la mise en scène
à explorer des zones non encore défrichées par Nordey.
En effet, depuis quelque sept années, Emmanuelle & Stanislas
s’efforcent de construire par capillarité complémentaire
un partenariat spécifique où celui-ci devenu son mentor
dramaturgique, celle-là, en disciple exclusive, lui renvoie une image
de parcours en étapes « infranchissables » à
vaincre au fur et à mesure avec, en émulation à la clef,
une éventuelle apogée… en point de mire !
Cependant pour « Elle », l’Amour ne relève
guère de l’épanouissement et de la satisfaction puisque
« l’Autre & l’Un » surfant sur les
désillusions successives, ses deux partenaires de scène (Thomas
Gonzalez & Laurent Sauvage ou Victor De Oliveira) sont constamment en
quête de variantes, de dérivatifs, d’alternatives qui
pourraient suppléer au déficit d’âme qu’ils
subissent plutôt que de le maîtriser.
L’acte sexuel est constamment évoqué, de manière
latente et sous-jacente, sous de multiples apparences sans que jamais le
moindre passage à l’acte n’affleure la représentation
théâtrale scandée au diapason des seuls mots
« bruts » de Pellet.
Ainsi, le souhaite Stanislas Nordey vouant un culte sans limite à
la force du langage dans toutes ses composantes d’autant plus si
transgressives.
Par ailleurs, selon des méthodes ayant géré au summum
sa carrière et sa destinée d’acteur culte, toute symbolique
s’affiche ici la référence à Erich Von Stroheim
représentant à lui seul l’incarnation de la mythomanie,
de la mystification et du mensonge tout azimut portée au niveau
inégalable de chef d’œuvre.
Alors faudrait-il, à l’instar de cet Artiste de l’Absolu,
prendre ses désirs pour des réalités et ainsi se composer
une identité flatteuse à ses propres yeux avant que d’en
phagocyter autrui ? Voilà effectivement une des pistes parmi
d’autres étudiées par les membres du pseudo triangle amoureux
avant que de fantasmer un rejeton qui, par son existence, pourrait acquérir
le talent de rebattre les cartes de leur contingente destinée
humaine.
Quant à Emmanuelle Béart, à la recherche d’un
« anonymat » quasi métaphysique pour mieux
appréhender son travail de troupe, la comédienne avance ainsi
sur la carte du Tendre accompagnée d’autant de cavaliers servants
que ceux-ci sont tenus à distance grâce à la magie du
texte théâtral et alors qu’en contrepoint formel l’un
des comédiens s’essaye à la performance de jouer
« nu » de bout en bout du
« happening » scénographique ainsi projeté
par l’actrice « engagée » s’étant,
elle par ailleurs, mise en congé délibérément
indéterminé... du Cinéma.
Theothea le 28/04/17
|
APRES LA
REPETITION
de Ingmar
Bergman
mise
en scène Nicolas Liautard
avec Sandy Boizard, Carole Maurice
& Nicolas Liautard |
****
Théâtre de la
Tempête
|
|
LA JOURNEE D'UNE
RÊVEUSE (Et Autres Moments...)
de
Copi
adaptation &
mise
en scène Pierre Maillet
avec Marilu
Marini & au piano Lawrence
Leherissey |
****
Théâtre du
Rond-Point
|
Dans ce Théâtre du Rond-Point où Madeleine Renaud
fut la première grande dame à outrepasser les normes en incarnant
jusqu’au grand âge la « Winnie » de Beckett
dans « Oh les beaux jours ! » ou l'intrépide
« Maude » en compagnie de son jeune
« Harold », il est heureux que le flambeau de la
transgression soit repris par la main experte d’une égérie
ayant inspiré et subjugué auteurs et metteurs en scène
tout à la fois fantasques et visionnaires à l’instar de
Copi & Alfredo Arias soufflant dans le sens de l’absurdité
et de l’étrangeté en provenance d’Amérique
du Sud.
De son plein gré, Marilú Marini serait donc en charge de
mémoire tout autant que d’actualisation de l’entendement
affrontant l’irrationnel jusqu’à faire céder les
sirènes du bon goût ou de la cohérence apparente.
Sur la scène arpentée par la muse mythique en attente du
public prenant place des sièges attribués, celle-ci cherche
à s’échauffer physiquement et psychologiquement auprès
des spectateurs à peine persuadés que l’artiste est, de
fait, déjà parmi eux sans aucun préambule… puisque
effectivement son « show » n’est pas encore
commencé.
Cependant, au top départ des lumières se focalisant sur
le plateau, Marilú Marini va d’emblée s’afficher
en feu d’artifices comportementaux et verbaux que, jamais au grand jamais,
les bonnes manières et le juste ton n’oseraient formellement
revendiquer.
En effet, de ruptures de rythmes en postures provocatrices, de
compréhensions bienveillantes en colères feintes, de
naïveté délibérée en cynisme ébahi,
toute la palette de son savoir-faire, sans pour autant avoir l’air
d’être experte en une discipline plus qu’une autre, fait
œuvre d’autorité et de charme qu’aucun pouvoir alternatif
ne pourrait contrarier.
Seule compte la magie du clown obligeant le public à la suivre
sur son terrain de prédilection tout en ayant la faculté de
pouvoir en permanence changer à vue les règles du jeu la reliant
par un fil ténu mais néanmoins tellement résistant sous
l’authenticité du geste artistique.
Donnant de-ci de-là des coups de pattes politiques &
idéologiques sous-jacents aux métaphores scénographiques
explicites, l’actualité hexagonale peut surgir ponctuellement
au sein d’un tableau induisant une nostalgie profonde et prégnante
notamment à l'évocation de la culture argentine.
Loin de vampiriser Copi à elle seule, la comédienne lui
rend ainsi le meilleur hommage possible en impliquant son propre talent
jusqu’aux confins de l’autodérision où le ridicule
ne pourrait la tuer tant la conviction d’évoluer au-delà
des contingences rationnelles se présente comme la garantie à
vivre pleinement le surgissement théâtral dans l’instant
présent… et donc forcément exclusif et unique.
Bien entendu, Lawrence Leherissey son pianiste, fort doué, évolue
dans la sphère du multitâches puisque son rôle de partenaire
musical se dédouble en une complicité de faire-valoir autant
que de souffre-douleur assumée jusque dans les contradictions du rejet
patenté mêlé à une dévotion admirative
à connotations oniriques.
Marilú Marini a atteint désormais une aura de Diva que le
Rond-Point a ainsi l’intuition judicieuse d’honorer et serait,
en quelque sorte, bien inspiré d’en réitérer les
opportunités d’une célébration récurrente…
comme d’ailleurs pourrait l’être judicieusement, par association
implicite, celle invoquée de Madeleine Renaud.
Theothea le 08/05/17
|
LE TESTAMENT DE
MARIE
de Colm
Toibin
mise
en scène Deborah Warner
avec Dominique Blanc
|
****
Théâtre de
l'Odéon
|
Pour peu que le Théâtre de L’Europe se soit subitement
transformé en Cathédrale selon la circonstance, voici donc
qu’une procession de spectateurs, en s’élevant de cour à
jardin, déambule sur la scène, curieuse d’y voir de plus
près les bougies brûlant en hommage à la Vierge Marie,
elle-même statufiée dans une cage de verre sous les traits
d’une Dominique Blanc au teint cireux plus vrai que nature… pourtant
bel et bien comédienne à part entière comme jamais
!…
En effet, quelques instants avant que ne disparaissent du décor
scénique tous les atours symboliques de l’effet bondieuserie
en compagnie d’un vautour apprivoisé, métaphoriquement
friand de petits lapins, la vénération touristique bat son
plein sur les planches de l’Odéon à l’instar d’un
pèlerinage laïque devant bientôt laisser place à
la dramaturgie théâtrale dédiée.
Coup de baguette magique sur la citrouille de verre et voici que, dans
un cri primal digne d’une actrice se désinhibant de tout corset
liturgique et idéologique, Dominique Blanc débute son monologue
au sein d’un cauchemar éveillé… en pleine confidence
avec le public, son unique rempart du drame par lequel le nouveau testament
l’a « sanctifiée » à son insu depuis
deux mille et quelques années.
C’est donc l’histoire d’une mère et de son fils
« fugueur » que celle-ci va se conter à
elle-même, en se tenant au plus loin des pressions destinées
à rendre synoptiques les évangiles qui relateront
l’avènement du fils de Dieu sur terre par l’intermédiaire
de l’immaculée conception tout en préparant son ascension
triomphale aux cieux non sans avoir expié auparavant, dans
l’extrême douleur, les péchés de l’humanité
tout entière.
Voilà donc Marie en exil à Éphèse jamais remise
de cette période tragique où elle assista en témoin
médusé au départ de son fils du domicile familial, sis
à Nazareth, pour rejoindre une « bande de
désaxés » en devenant leur chef charismatique
jusqu’au point où ces « disciples », à
force d’admiration illimitée l’installant sur un
piédestal, finissent par le nommer « fils de Dieu ».
Entraîné par ce tourbillon du pouvoir exercé sur les
foules, le fils prodigue se mit alors à effectuer d’ambigus miracles
démultipliant encore davantage la fascination collective que Marie
pressentait comme une arme prête à se retourner contre son rejeton
adoré.
En conséquence, malgré tous les efforts de cette mère
invitant son fils à reprendre raison et pieds sur terre, il n’en
faudra pas davantage que la redoutable proclamation « Roi des
juifs » pour mettre définitivement le feu aux poudres
entraînant sa condamnation à mort.
Au diapason d’un chemin de croix gravi en calvaire sur le mont des
Oliviers, Marie se remémore tous les moments du supplice
jusqu’à l’infernale crucifixion dont chaque clou la
pénètre à jamais jusqu’au fond de sa tourmente
maternelle infinie.
A l’image de ces jeunes contemporains s’engageant dans des combats
chimériques au nom de causes transgressives face à des familles
désarmées et terrassées, rien ne pourrait venir consoler
Marie encore moins justifier sa perception d’une responsabilité
entravée par le mal absolu ayant gangrené le destin d’un
fils magnifique à qui tous les espoirs de réussite sociale
étaient permis.
A la suite de Fiona Shaw à Broadway en 2013 puis à Londres
en 2014, la performance de Dominique Blanc, pareillement sous la direction
de Deborah Warner, est emplie d’une intensité, d’une
gravité, d’une force atavique à dépasser les croyances
contingentes; cela autorisera Marie de clamer, en épilogue au roman
de Colm Toibin, à haute et intelligible voix :
« La soi-disante mission de mon fils n’a pas sauvé
le monde. Cela n’en valait pas la peine. »
Theothea le 12/05/17
|
LUCRECE BORGIA
de Victor
Hugo
mise
en scène Henri Lazarini & Frédérique
Lazarini
avec
Frédérique
Lazarini, Emmanuel Dechartre, Didier Lesour, Marc-Henri Lamande, Hugo Givort,
Louis Ferrand, Clément Héroguer, Pierre-Thomas Jourdan, Adrien
Vergnes, Kelvin Le Doze |
****
Théâtre
14
|
Au théâtre 14 est repris depuis le 19 mai "Lucrèce
Borgia", spectacle créé en 2014 par Henri Lazarini et
Frédérique Lazarini sa fille, fondatrice de la Compagnie "Minuit
Zéro Une" et qui joue, ici, le rôle-titre.
Des mises en scène très gothiques du drame ont été
réalisées récemment, comme celle de Denis Podalydès
au Français avec Guillaume Gallienne en travesti puis remplacé
par Elsa Lepoivre et celle de David Bobée avec Béatrice Dalle
qui a fasciné le public devant le décor particulièrement
envoûtant du Château de Grignan.
Les Lazarini proposent ici une version plus modeste, d’une
esthétique plutôt minimaliste et dépouillée par
l'absence de décor, juste des fauteuils, mettant ainsi en valeur l'ampleur
lyrique du texte hugolien. La pièce de Victor Hugo, en trois actes,
écrite en 1833, relève du pur mélodrame avec ses sentiments
exacerbés, ses situations dramatiques, ses émotions poussées
au paroxysme.
Dans leur subtile mise en scène, les personnages évoluent
sur fond d'un simple écran rouge et noir, habillés eux-mêmes
de rouge et surtout de noir pour mieux marquer la dichotomie des pulsions
qui animent la pièce : l’Amour dévorant et la Mort qui,
telle une ogresse dévastatrice, va tout submerger.
Dans une lumière crépusculaire, le rideau se lève
sur des hommes qui portent des masques macabres. Ils avancent alignés
vers les spectateurs, accompagnés par une musique lancinante (John
Miller), créant une atmosphère lugubre, avant d’arracher
leur masque pour que commence la tragédie à visages
découverts.
Le groupe de jeunes nobles tout de noir vêtus évoque les
affaires de la famille Borgia.
Gennaro (Hugo Givort), élevé par un pêcheur quelque
part sur l’Adriatique, devenu à vingt ans un capitaine plein
d’ardeur, est séduit par Lucrèce, qu'il a rencontrée,
masquée, lors d'un bal dans la cité des Doges. Lucrèce,
en retour, troublée par les lettres qu'il lui lit, lui témoigne
un amour débordant.
Les compagnons de Gennaro lui révèlent l'identité
de la femme qu'ils humilient en criant leurs noms et leurs parents
assassinés sous les ordres de la duchesse. Devant l'atrocité
des crimes et une telle démonstration de cruauté, le coeur
de Gennaro s'emplit de haine. Vilipendée, bafouée, Lucrèce
n'aura plus qu'une envie, leur faire payer l'outrage infligé.
Son obsession de châtiment deviendra terrifiante lorsqu'elle apprendra
par le duc d'Este qu'un individu a arraché le B de BORGIA gravé
sur les armoiries de leur palais résidentiel, laissant visible aux
yeux de tout Ferrare le mot avilissant de "ORGIA " et renvoyant ainsi une
image dévalorisante de sa personne ! "Or, je vous le déclare,
monsieur, je veux que le crime d’aujourd’hui soit recherché
et notablement puni...!".
Le Duc Alphonse d’Este, quatrième mari de Lucrèce (les
trois précédents ont été assassinés)
interprété par Emmanuel Dechartre, ceint d'une toge au profond
velouté noir, sobre et fin manipulateur, condamne à mort Gennaro
pour crime de lèse-majesté et l’empoisonne avec le
célèbre poison Borgia. Par un subit volte-face, Lucrèce
veut l'épargner et implore Gennaro de boire le non moins
célèbre contre-poison Borgia. C’est que Lucrèce
est une mère sublimée d’amour, écartelée
par un secret non avouable : Gennaro est un Borgia, fruit de son amour incestueux
avec Jean, l’un de ses frères.
Flamboyante et de rouge vêtue, Frédérique Lazarini
est Lucrèce Borgia. Elle alterne avec une conviction survoltée
des phases d'une violence impitoyable, des moments d’exubérante
animosité avec des phases de tendresse et de faiblesse aussi
délicates qu’un cœur aimant et souffrant peut exprimer.
Aidée par l'ambigu et machiavélique Gubetta, dans les oripeaux
d'une mendiante, mi-diseuse de mésaventure, mi-confidente, joué
par un délirant Didier Lesour, elle ira jusqu'au bout pour éliminer
les nobliaux qui l'ont humiliée, au cours d'une dîner funèbre
chez la Princesse Négroni, réduite, ici, à l' étrange
apparition surréaliste d'une femme masquée enfermée
dans une cage. On assiste alors à une interminable beuverie de six
gaillards vénitiens s'empoisonnant lentement sans le savoir au vin
de Syracuse, au son des chants mortuaires de moines pénitents. Scène
qui se révèle longue et assez plate, les jeunes gens dont la
distribution est inégale se contentant de se lancer les bouteilles
et de les rattraper en vociférant.
Hormis ce bémol, c'est le texte monstre et furieux de Hugo qu'on
entend, théâtre des passions exaltées et contradictoires
où le bien et le mal se percutent, où le grotesque et le sublime
se côtoient. A la fois, déchaînée par l'envie de
vengeance et transcendée par l'amour maternel, Lucrèce,
schizophrène dans ses délires, attise la pitié. Dans
le malheur, cette âme difforme retrouve une réelle et lumineuse
beauté.
La tragédie grecque n’est pas loin : la pureté du sentiment
qu’éprouve Lucrèce la contraint à se taire et cause
fatalement sa perte et celle de l’être chéri. Elle est
désormais revêtue du noir de la Mort. Venise avait permis à
une mère de retrouver son fils. Ferrare en sera leur tombeau.
Cat’s / Theothea.com le 15/06/17
|
Recherche
par
mots-clé
 |

|
|