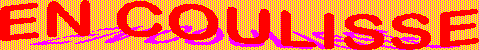Les
Chroniques
de
 |


 |
 
23ème
Saison
Chroniques 23.56
à
23.60 Page
444
©
Theothea.com
©
Theothea.com
©
Theothea.com
©
Theothea.com
71ème
Festival de
Cannes
2018
La Croisette 2018
Les Molières
2019
Les Nominés
2019
Les
Molières
2018
R E V I V A L
Stones 14 on Fire
Paris
Wight ! + 48 années
après
Toutes
nos
critiques
2018 -
2019
Les
Chroniques
de
Theothea.com
sur

THEA
BLOGS
Recherche
par mots-clé
THEA
BLOGS
|
LE CANARD A
L'ORANGE
« Le Canard à l’Orange » (
Recette Nicolas Briançon ) enthousiasme La
Michodière
de
William Douglas
Home
mise
en scène Nicolas
Briançon
avec
Nicolas
Briançon, Anne Charrier, Francois Vincentelli, Alice Dufour &
Sophie Artur |
****
Théâtre de La
Michodière
Reprise Théâtre de Paris
|
De la « Vénus à la fourrure » jusqu'au
« Canard à l'orange », Nicolas Briançon
a l'art de régaler son public par des mises en scène où
les comédiens peuvent se distancier de leurs rôles en poussant
ceux-ci paradoxalement jusque dans leurs failles.
Cultivant le lâcher-prise, chacun y va de sa capacité à
exacerber une situation qu'il sent lui échapper pour mieux tenter
d’en reprendre le contrôle après l’essorage des pulsions
contradictoires agitant le précipité des ressentiments.
Quand, de surcroît, notre metteur en scène est également
partie prenante en tant que comédien, voici celui-ci jouant les
démiurges omnipotents façon Sacha Guitry mais laissant
apparaître ses propres vulnérabilités comme composante
de l’enjeu soumis au public.
Alors, si la séduction addictive fut le ressort selon lequel le
rapport de forces entre Thomas & Wanda (La Vénus ) avait dû
trouver son point d'équilibre salvateur au sein d'une dualité
attisée par des postures ambivalentes allant de la domination à
l’assujettissement ici, à La Michodière, c'est comme si
l'homme de spectacle se retrouvait de l'autre côté du miroir,
versant clown assumé, cultivant le paroxysme de l’empathie joyeuse
comme arme de déconstruction totale.
En effet, point question présentement de compromis petit bras,
bien au contraire, grand seigneur, l'artiste jette son va-tout selon la maestria
téméraire de celui qui joue à qui perd gagne avec ce
qu'il a de plus précieux.
En l'occurrence, Liz Preston, son épouse, est en train de vaciller
sur la pente du divorce, s'étant laissée conquérir par
un enjôleur prétentieux et sans vergogne.
Le départ définitif de l’épouse étant
sur le point de se conclure, Hugh Preston, le mari, ose alors un coup de
maître.
Il propose à John Brownlow, l'amant, de venir passer le week-end
au domicile familial sous prétexte de régler les procédures
juridiques à l'amiable tout en invitant, par ailleurs, Patricia, sa
propre secrétaire (Alice Dufour), afin d’objectiver le flagrant
délit des torts respectifs.
Ce stratagème risque-tout étant en passe de réussir,
il ne devrait plus rester qu'à développer tant d'ardeur et
de compétence à bien recevoir cet hôte de prédilection
que celui-ci, décontenancé par quelques circonstances
imprévues, perdrait peu à peu toute son aura au regard de la
conjointe infidèle.
Mais cela reste, bien sûr, plus facile à dire qu'à
exécuter !
Et c'est précisément tout l'art de Nicolas Briançon
d'avoir su tirer de ce chef d'oeuvre anglais, un tant soit peu désuet,
le puissant principe actif ne se souciant point d’une idéologie
misogyne et ringarde latente pour, a contrario, jouant avec le feu, transgresser
celle-ci par une énergie positive assumant pleinement la caricature
forcée.
A l’appui de cette réalisation menée tambour battant,
se trouve également la nouvelle adaptation de Marc-Gilbert Sauvajon
mieux formatée aux critères de l’époque contemporaine
ne s’embarrassant point des convenances et des codes de bonne
conduite.
En outre, la judicieuse idée d’avoir imaginer John, l’amant,
avec un accent belge quelque peu trivial, permet à Francois Vincentelli
de composer un personnage plein de fantaisie dont les réparties prennent
une saveur propre à déclencher les fous rires.
Gageons que la vaine impatience des gourmets ne verra jamais arriver sur
la table le fameux canard mais d’aucuns ne s’en offusqueront car
cela autorise Mme Gray, la cuisinière (Sophie Artur), de faire des
irruptions opportunes pour différer une armistice culinaire dont,
en définitive, personne ne voudrait.
Dans cette perspective, Anne Charrier (Liz) a la charge très
intéressante de faire évoluer sa perception amoureuse et affective
au fur et à mesure des audaces de son mari liées directement
au prorata des forfanteries de son amant, et c’est donc un véritable
régal pour les spectateurs d’assister à leurs rounds
successifs changeant ainsi peu à peu la nature du match libidinal.
Tous prennent un malin plaisir à se camper dans de beaux draps,
ceux dans lesquels le bon droit rejoint au bout du compte la juste cause,
fût-elle complètement antagoniste à celle des
partenaires.
Reste donc, en continuité insatiable, le point de vue du spectateur
se réjouissant d’observer que le ridicule, décidément,
ne tue point l’humour alors que se déclenchent les salves de
rire à chaque gong ponctué par le score des turpitudes
sociétales.
De fait, cet imbroglio intensément drôle donne à penser
que ces cinq comédiens ont vraiment de la chance d’être
ainsi, chaque soir, aux premières loges de cette comédie culte
pour laquelle, c’est un euphémisme, ils donnent vraiment beaucoup
d’eux-mêmes.
Theothea le 23/03/19
|
GUYS AND
DOLLS
« Guys and Dolls » Le Musical aux 5 Tony
Awards 1951... de Broadway au Marigny.
d'après
Damon Runyon
livret
Jo Swerling & Abe Burrows
Musique & paroles
Frank Loesser
mise
en scène & chorégraphie Stephen
Mear
avec
Ria
Jones, Clare Halse, Matthew Goodgame, Christopher Howell, Rachel Izen, Barry
James, Joel Montague, Matthew Whennell-Clark, Jack North, Brendan Cull, Ross
McLaren, Gavin Wilkinson, Ian Gareth Jones, Thomas-Lee Kidd, Jo Morris, Alexandra
Waite-Roberts, Emily Goodenough, Delycia Belgrave, Bobbie Little, Joanna
Goodwin, Robbie Mc Millan, Adam Dean & Louis Mackrodt |
****
Théâtre
Marigny
|
« Contraria Contrariis Curantur » annonce en
préambule Jean-Luc Choplin, directeur du Marigny, dans le programme
présentant ce Musical aux origines de la renommée internationale
de Broadway.
« Les contraires se guérissent par les
contraires », voilà en effet une synthèse
thématique pleinement appropriée au script de « Mecs
et Poupées » où se dessine l’atmosphère
précédant l’épilogue de la prohibition au sein
du New-York des années trente.
La faune de l’époque y faisait se côtoyer notamment
la pègre des parieurs de tout poil avec celle des adeptes idéalistes
de l’Armée du Salut. C’est en se référant
à ces deux communautés d’apparence
hétérogène que Damon Runyon rédigea ses nouvelles
très à la mode dont, par la suite, Jo Swerling et Abe Burrows
allaient tirer le livret de leur comédie à succès, mise
en musique et chant par Frank Loesser.
Un peu plus loin dans le programme, apparaît la recommandation
« A lire avant le lever du rideau » à laquelle
nous souscrivons pleinement de par son utilité manifeste.
En effet, le système de surtitrage utilisé actuellement
dans les théâtres est encore du domaine du palliatif pour lequel
les spectateurs sont incités à recourir modérément
tant que, contrairement à celle des écrans de cinéma,
la lecture des dialogues nécessitera de modifier l’orientation
de son champ de vision en marge de la scène.
En tout état de cause, lever la tête vers les cintres ou
la tourner à cour, à jardin ne peut être
considéré comme un outil de compréhension performant.
Donc le résumé francophone des deux actes de ce musical
ayant été bien assimilé en amont avec son "who’s
who"circonstanciel afférent, installons-nous confortablement dans
la salle du Théâtre Marigny dont la rénovation fut
inaugurée en septembre dernier par
« Peau
d’âne » sous l’égide de Michel Legrand
disparu récemment.
Voici donc que cette fable sur Broadway, montée de par le monde
à maintes reprises depuis sa création en 1950, est enfin
arrivée à Paris pour la toute première fois en ce mois
de mars 2019 sous version originale et dans une production assurément
haut de gamme.
L’éclosion chaotique de deux couples inattendus, la chanteuse
Miss Adélaïde (Ria Jones) avec Nathan Detroit (Christopher Howell)
& La Missionnaire Sarah Brown (Clare Halse) avec Sky Masterson (Matthew
Goodgame), en fonction des tensions sociales liées à des
mœurs antagonistes, ne pourrait être adaptée à un
autre contexte que celle de la culture américaine tant celle-ci s’y
révèle dans sa spécificité sociologique.
C’est d’ailleurs cette improbabilité qui sera le fil
conducteur à suspens des tribulations conduisant à la parade
triomphante d’une société new-yorkaise se réjouissant
de son propre éclectisme pragmatique.
Et ce d’autant plus que ce monde interlope dans lequel nous
pénétrons durant deux heures et demie n’a pas son pareil
dans nos références occidentales et que, de surcroît,
il s’avère distancié de notre connaissance contemporaine
des Etats-Unis.
Sans néanmoins être pour autant exotique, l’approche
d’une communauté par une autre, la recherche du compromis sans
froisser les susceptibilités de l’éventuel partenaire,
la propension à vouloir influencer sans succomber au messianisme,
tous ses facteurs se disputent effectivement les intérêts financiers
des truands confrontés au puritanisme de ceux qui prônent la
rédemption… au beau milieu parisien d’une vingtaine de
comédiens - danseurs - chanteurs anglophones.
L’orchestre du Théâtre Marigny installé en fosse
sous la scène est quasiment invisible de la salle, sauf à
s’en rapprocher durant l’entracte pour en entrevoir quelques-uns
des instruments.
La qualité du spectacle s’apprécie dans tous les
compartiments du jeu artistique : de celle du casting top-niveau à
celle de la puissance des voix, de celle du décor jouant avec les
lumières à celle des costumes rehaussés par les couleurs
vives, de celle des chorégraphies dynamiques à celle de la
mise en scène précise, joyeuse et humoristique (signées
ensemble Stephen Mear)… bref ce régal des sens en éveil
est une ode à l’âme de la comédie musicale dans
son essence comme dans son divertissement.
En faisant ainsi œuvre de pédagogie initiatrice à
l’égard d’un public français encore néophyte,
dans la lignée de ce qu’il avait déjà entrepris
au Châtelet élaborant une programmation puisant aux valeurs
sûres et constitutives de la Comédie musicale, Jean-Luc Choplin
monte encore d’un cran les exigences de son projet ambitieux à
l’égard de la renaissance du Théâtre Marigny pour
laquelle il convie désormais le public international auquel
s’adresse également son dessein de haute envergure.
Les Champs-Elysées au diapason de Broadway, voilà une bien
belle gageure s’offrant un brillant avenir totalement ouvert !
Theothea le 10/04/19
|
LE PAYS LOINTAIN
« Le Pays Lointain » de Jean-Luc Lagarce
en version générationnelle Hervieu-Léger à
l’Odéon
de
Jean-Luc Lagarce
mise
en scène Clément
Hervieu-Léger
avec
Aymeline
Alix, Louis Berthélemy, Audrey Bonnet, Clémence Boué,
Loïc Corbery de la Comédie-Française, Vincent Dissez,
François Nambot, Guillaume Ravoire, Daniel San Pedro, Nada Strancar
& Stanley Weber |
****
Théâtre de
l'Odéon
|
De « Juste la fin du monde » au « Pays
lointain », il n’y a qu’une seule et même œuvre
qui s’approfondit et se sublime en un cri final que Louis ne devrait
pas lancer puisque tel est son destin de ne point parvenir à exprimer
son départ définitif et c’est donc par cette voix muette
pour toujours que le dramaturge nous revient de profundis, plus que jamais
présent sur les planches après un délai de latence.
Si dans la première version, seule la visite impromptue aux membres
de sa famille encore vivants servait de fil conducteur à son ambivalent
retour aux origines, la remise en question de cet ouvrage allait, par la
suite, ouvrir le champ des possibles jusqu’aux rencontres les plus
improbables dans la vraie vie alors que l’imaginaire symbolique
s’apprêtait à prendre le relais en multipliant l’esprit
de famille à toute personne croisée ici-bas ayant retenu
l’attention de Louis ou mieux, son affection, fût-ce la durée
du coup de foudre !
Ainsi, faisant fi du distinguo entre être et avoir été,
Louis convoque dans ce deuxième opus revisité tout son monde
intérieur peuplé de présences virtuelles, d’absences
fantomatiques ou de rencontres fortuites ayant jalonné,
façonné ce que le jeune homme est devenu en cette phase finale
de son parcours terrestre.
Cependant dans ce no man’s land scénographique au bord d’une
autoroute où se lézardent une épave de voiture à
l’abandon ainsi qu’une cabine téléphonique d’une
autre période, celle de la désaffection, ce n’est pas
le pan d’un mur délimitant le terrain vague qui pourrait temporiser
la libre expression des dix personnages représentatifs, ici sur les
planches de l’Odéon, d’au moins trois tribus, celle de la
famille institutionnelle (Antoine le frère, Catherine la belle-soeur,
Suzanne la sœur, le père mort déjà & la
mère), celle des affinités choisies (l’ami de longue date,
Hélène la fiancée, l’amant mort déjà,
le garçon - tous les garçons -, le guerrier - tous les guerriers
- ) et enfin celle des dix comédiens rassemblés par le metteur
en scène autour de l’intrépide Louis (Loïc
Corbery).
20 ans après les 20 ans de la bande à Lagarce, Clément
Hervieu-Léger a, en effet, atteint l’âge qu’avait
le narrateur lors de cet ultime écrit considéré par
beaucoup comme son chef d’œuvre dont il allait mettre un point
final juste quelques jours avant de quitter l’existence.
Sans doute faudrait-il y ajouter une quatrième communauté,
celle des spectateurs, observateurs et témoins impliqués de
cet instant où se rejoue l’histoire générationnelle
des uns et des autres, tous confrontés qu’ils le veuillent ou
non à la nostalgie du futur antérieur, cet espace temps
indéterminé où le « Je me souviens »
se manifeste soit en phase, soit en confrontation avec celui du partenaire
ayant un point de vue similaire ou différencié concernant ce
« pays lointain » et pourtant mentalement si proche.
A n’en pas douter, si durant quatre heures, Jean-Luc Lagarce ressasse,
répète, réitère, approfondit sa pensée,
sa mémoire, sa conscience, c’est aussi parce que celle-ci
s’inscrit dans une époque, un contexte, une configuration où
est en train d’éclore un fléau dévastateur impossible
à ignorer ou à contourner; il n’empêche, l’auteur
ne le nommera jamais et ne désignera aucunement le SIDA comme le bouc
émissaire du malheur s’étant abattu sans crier gare.
A ce titre, apparaît la dimension universelle et intemporelle de
cette pièce testamentaire qui se répand désormais sur
la planète à renfort de traductions et d’adaptations autour
de la thématique pérenne rassemblant la notion de famille sous
un concept en expansion indéfinie, diverse et paradoxale.
En l’occurrence, celle des liens du sang va se vivre sous une sorte
de paranoïa partagée de gestes fusionnels autant
qu’émotionnels alors que celle des rencontres électives
se ressentira en effusions et abandons successifs sans qu’il soit
envisageable d’en discerner le démiurge, si ce n’est
l’horloge qui égrène son leitmotiv.
Comment ne pas rester coi avec un imperceptible sourire permanent au coin
des lèvres, lorsque Louis, le principal intéressé à
cette rencontre généralisée, ne peut que constater la
formidable énergie qu’il lui aura fallu produire pour qu’elle
ait lieu et, concomitamment, ce douloureux sentiment de ne point parvenir
à communiquer la moindre parcelle de vérité qui pourrait
suspendre le temps en un signifiant absolu pour tous ?
Les onze comédiens réunis grâce à Clément
Hervieu-Léger sont touchants et percutants car chacun, dans son registre,
est en permanence relié par osmose à l’équipe occupant
constamment le plateau même pendant l’entracte alors que Nada
Strancar pourrait, elle, s’en révéler le point de convergence
ou de ralliement.
Le vécu sur scène s’apparente à l’instant
unique développé, ici et maintenant durant la soirée
entière, pour évoquer, distiller, se remémorer, contredire,
s’exaspérer, se rapprocher et se surprendre, bref pour exister
!… l’espace d’une représentation théâtrale
forcément exceptionnelle.
Theothea le 29/03/19
|
QUI A TUE MON PERE
« Qui a tué mon père »
Création Stanislas Nordey & Edouard Louis à La
Colline
de
Edouard Louis
mise
en scène Stanislas Nordey
avec
Stanislas
Nordey |
****
Théâtre de La Colline
/ TNS
|
C’est seulement par apparence syntaxique que le titre de la pièce
théâtrale d’Edouard Louis poserait question car l’absence
de point d’interrogation ne relève ni de l’oubli, ni d’une
abstraction esthétique, ni même d’une préciosité
créative.
En effet, grâce à la contraction sémantique du pronom
relatif « Ce qui », « Celui qui »
ou même « Ceux qui » en une seule entité
représentative « Qui », le titre ainsi libellé
suggère une énigme à résoudre.
En revanche, s’il était transformé en « Ce
qui a tué mon père », cet intitulé pourrait
résumer le contenu d’une « pièce à
conviction » voire même la compilation de justificatifs
permettant de constituer un dossier à charge.
Et tel est sans doute réellement l’objectif poursuivi par
Edouard Louis mais comme, sans être une commande, cet objet
littéraire, né d’un travail de quête et d’analyse
à partir d’une idée directrice soumise à l’auteur
par Stanislas Nordey, correspondait à la perspective implicite d’en
réaliser un spectacle engageant la réciprocité de fait
d’un tel binôme artistique, cela pouvait s’avérer
fort judicieux de laisser planer un doute et un suspens dramaturgiques sur
cette création en incitant le futur spectateur à se poser
effectivement la question : « Mais qui donc aurait tué le
père d’Edouard Louis ? »… tout en méconnaissant
que celui-là est actuellement vivant.
Ainsi, on le comprend aisément à demi-mot, il s’agirait
bel et bien d’un pamphlet à vocation symbolique mais dont la
teneur pourrait aussi s’apparenter à celle du mouvement
sociétal contemporain pointant directement le hiatus existant entre
le monde des dominants et celui des dominés.
C’est donc d’abord l’histoire d’un retour, celui
d’un fils ayant dû s’extraire de l’environnement familial
pour cause d’incompréhension existentielle et culturelle.
Et si les griefs reprochés de part et d’autre étaient
multiples et inconciliables à l’origine, serait néanmoins
venu, désormais, le temps non d’un pardon hors sujet mais
celui du besoin de comprendre les causes systémiques ayant enclenché
la rupture.
Et voilà donc que se dessine en creux, au regard du spectateur,
le portrait d’un homme d’une cinquantaine d’années
n’ayant plus la capacité d’autonomie car la machine à
anéantir les corps aurait effectué son travail de sape depuis
sa naissance jusqu’à aujourd’hui.
En effet, reproduisant de générations en générations
l’abnégation du travailleur ayant intégré les codes
d’autodestruction, le père aurait également tenté
d’inculquer à son fils les principes du renoncement alors même
qu’à son insu ceux-ci le laminaient progressivement de
l’intérieur.
Edouard Louis fustige donc les normes de cette éducation censurant
le désir et l’épanouissement au nom de valeurs coercitives
imposées par la classe des nantis à celle des sans ressources.
Que ce soit sur le plan de l’éthique, du législatif
ou de la gouvernance, ceux-ci forceraient ceux-là à abdiquer
insidieusement.
C’est cette parole de rébellion vitale que Stanislas Nordey
a décidé de prendre en charge pour la clamer haut et fort,
d’abord sur la scène de La Colline puis en tournée, la
faisant sienne en articulant les syllabes jusqu’à ce qu’elles
résonnent au tréfonds des consciences.
Son style déclamatoire à nul autre pareil détient
l’immense avantage de sans cesse revenir à la charge comme s’il
labourait en profondeur le terreau cognitif en même temps que celui
de la vigilance.
La scénographie l’accompagne d’une éclosion successive
de mannequins similaires évoquant le spectre paternel en des poses
régressives hantant la parole filiale.
Enfin, par-delà ce thème revendicatif d’équité
civique mis en exergue, il est intéressant d’apprécier
la performance impliquée du comédien Stanislas arpentant le
plateau en quête de contact trans-relationnel, à l’aune
de sa révélation médiatique d’avoir lui-même
renoué récemment des liens avec son propre père, le
metteur en scène Jean-Pierre Mocky, après une très longue
période d’abstinence tacite entre eux deux.
Theothea le 25/03/19
|
LA TRILOGIE DE LA
VENGEANCE
« La Trilogie de la Vengeance » Acuité
triplée par Simon Stone cloisonnant l’Odéon Berthier
de &
mise en scène Simon
Stone
avec
Valeria
Bruni Tedeschi, Eric Caravaca, Servane Ducorps, Adèle Exarchopoulos,
Eye Haïdara, Pauline Lorillard, Nathalie Richard, Alison Valence et
la participation de Benjamin Zeitoun |
 **** ****
Théâtre de L'Odéon
Berthier
|
En multipliant les points de vue des spectateurs, Simon Stone invente
une scénographie cloisonnée dont la chronologie est aléatoire
en fonction de la répartition en groupes, déterminée
au moment de l’obtention du billet au contrôle du Théâtre.
En l’occurrence, selon les trois premières lettres de
l’alphabet identifiantes, le parcours sera structuré en un triptyque
séquencé de deux entractes pour autant de lieux dédiés
que le public investira successivement durant près de 4 heures.
Nécessairement le ressenti sera différent au gré
de chaque perception subjective selon un ordre événementiel
sans véritable norme établie pourvu notamment que le flash
back soit accepté comme style à part entière.
Mais, en définitive, qu’importe le cycle dans lequel le spectateur
lambda est inscrit, sa vision de la pièce sera forcément la
bonne ou plus exactement celle des trois pièces concomitantes car
si la vengeance féminine face au machisme séculaire est en
thématique ouverte, les trois scénarios proposés se
complètent à l’unisson selon une perspective univoque
se référant à John Ford, Thomas Middleton, William
Shakespeare & Lope de Vega.
Le principe en est simple, trois exemples culturels significatifs de la
tyrannie masculine exercée sur l’autre sexe au XVIIème
siècle sont appelés à susciter un effet boomerang sous
forme de revanche et de châtiment universels.
Avec un casting essentiellement féminin paradant face à
un seul mâle chargé de tous les dévoiements, se propulse
un enchaînement de rôles au sein d’un manège
théâtral d’une folle inventivité.
En effet, au cours de la soirée, les huit comédiens vont
interpréter à trois reprises leurs prestations consistant à
jouer synchrones trois histoires différentes sur trois scènes
adjacentes mais compartimentées en modules de jeu totalement
étanches.
Cela pourrait fort ressembler au don d’ubiquité mais le
spectateur, lui, ne peut, de fait, percevoir en temps réel qu’un
tiers du travail de chaque artiste.
Tout se passe comme si pour celui-là s’étant
déplacé dans un nouveau décor après le premier
entracte, la prise de conscience s’effectuait soudain que l’acteur,
présent ici et maintenant devant lui, provenait effectivement d’une
configuration scénique autre pour s’apprêter à se
rendre ensuite dans une troisième et cela, à l’instar
des partenaires, de manière répétitive au cours de chacune
des périodes de cette performance ternaire.
Cela pourrait occasionner une sorte de frustration récurrente chez
l’observateur n’étant pas en mesure de considérer
l’ensemble de cette surprenante réalisation alors que celui-ci
essaierait en vain d’intégrer sa propre vision partielle dans
un imaginaire reconstitué où les coulisses apparaîtraient
en arrière-plan d’une course-poursuite menée sous le triple
engagement des interprètes télécommandés par
cette mise en scène stupéfiante.
Ce fabuleux tournis perdurera d’ailleurs jusqu’à la
dernière seconde du spectacle car, même lors des saluts,
l’ensemble des protagonistes devra se déplacer par duos ou trios
de façon à ce que, en chacun des trois lieux, les applaudissements
puissent s’objectiver simultanément.
Jamais donc le public n’aura l’occasion de pouvoir regarder
et applaudir tous les comédiens réunis ensemble.
Si cette fort ingénieuse direction d’acteurs est amenée
ainsi à son terme en apothéose, elle peut néanmoins
engendrer une sorte d’impression schizophrénique d’avoir
été le jouet d’un fantasmagorique tour de passe-passe.
A chacun d’apprécier à sa juste valeur cette prouesse
scénographique spectaculaire en hyper activité se déployant
à la fois sous vision angulaire, frontale ou bi-frontale depuis les
gradins voire même sous isolation phonique vitrée avec parfaite
sonorisation des voix mais étrangement non géo-localisables.
Quant au matériel humain, confirmons qu’il est pleinement
à la hauteur de cette entreprise, c’est-à-dire
impétueux, déterminé et néanmoins adaptable aux
aléas :
C’est, en tout cas, une réelle satisfaction de pouvoir
apprécier les sept jeunes femmes au charisme différencié
se confrontant à l’antagonisme phallocratique selon de multiples
formes de résistance comportementale.
Valeria Bruni Tedeschi, Servane Ducorps, Adèle Exarchopoulos, Eye
Haïdara, Pauline Lorillard, Nathalie Richard & Alison Valence naviguent
à vue solidaire sur la même embarcation artistique pour
défendre chèrement la peau et les convictions de leurs
guerrières.
Eric Caravaca, lui, sur le registre du boudeur cynique et autoritaire
se démultiplie à remplir son cahier des charges oppressives
pour parfaire son incarnation de l’aveuglement masculin.
Au demeurant, à coup sûr, cette réalisation hors du
commun fera « date » dans la création théâtrale
; de là à dire qu’elle fera « école »
c’est envisageable, pourvu qu’elle parvienne à faire oublier
complètement son dispositif technique au seul profit d’un enjeu
dramatique fort et convaincant.
Theothea le 03/04/19
|
Recherche
par
mots-clé
 |

|
|